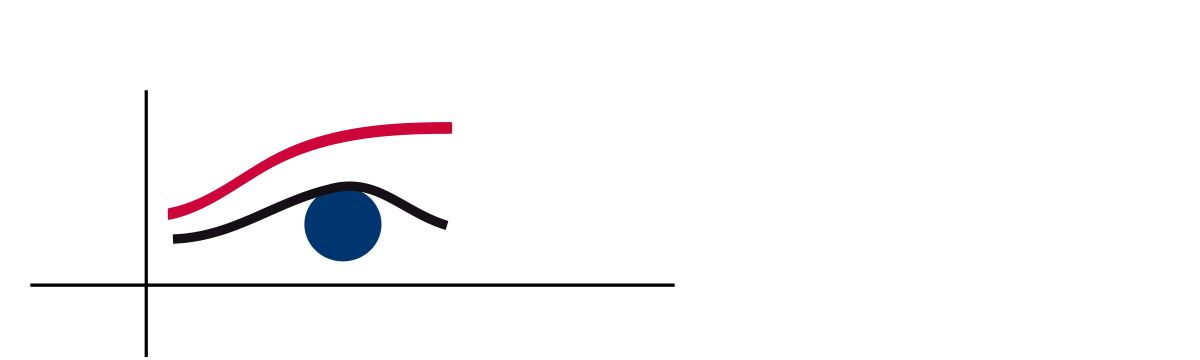SVB, Crédit Suisse, … au suivant ?
 Le 17 mars 2023, Silicon Valley Bank (SVB), 16ème banque aux Etats-Unis par sa taille, déposait le bilan. Le jour même, l’action de Crédit Suisse, 17ème plus grande banque d’Europe, chutait de plus de 60% et sera rachetée deux jours plus tard par son principal concurrent, UBS, sous la pression du gouvernement helvète. Autour du 15 mars, les principales valeurs bancaires européennes perdaient plus de 10%, lâchant près de 20% en un mois. On peut donc légitimement se demander si nous ne sommes pas sur le point de revivre le scénario d’une crise bancaire mondiale avec les effets que l’on connait.
Le 17 mars 2023, Silicon Valley Bank (SVB), 16ème banque aux Etats-Unis par sa taille, déposait le bilan. Le jour même, l’action de Crédit Suisse, 17ème plus grande banque d’Europe, chutait de plus de 60% et sera rachetée deux jours plus tard par son principal concurrent, UBS, sous la pression du gouvernement helvète. Autour du 15 mars, les principales valeurs bancaires européennes perdaient plus de 10%, lâchant près de 20% en un mois. On peut donc légitimement se demander si nous ne sommes pas sur le point de revivre le scénario d’une crise bancaire mondiale avec les effets que l’on connait.
La question se pose : faut-il avoir peur de nos banques ? La régulation est-elle assez stricte ? Les institutions qui dépendent du régulateur bancaire européen n’ont jamais été aussi solides, mais les réactions des investisseurs, y compris des épargnants, peuvent créer de grosses turbulences.
En 2008, la crise financière trouvait son origine dans les subprimes. Via la titrisation, ces crédits hypothécaires toxiques se sont retrouvés sur le bilan d’un grand nombre de banques (voir le numéro 64 de Regards économiques). Ne connaissant pas précisément l’exposition des autres institutions financières à ces produits, la méfiance contamina l’ensemble du secteur et le robinet des liquidités interbancaires fut coupé. La crise de 2008 révéla au grand jour le risque de liquidité des banques (à savoir le risque de ne pas pouvoir se refinancer), y compris de celles présentant un risque systémique. Elle mena à des réformes importantes dans la régulation bancaire, notamment via l’introduction des ratios de liquidités de Bâle III (Leverage Coverage Ratio, LCR et Net Stable Funding Ratio, NSFR) destinés à mesurer les risques associés (voir le numéro 96 de Regards économiques). Les problèmes de SVB et de Crédit Suisse ont des origines différentes, mais engendrent le même climat de méfiance et de panique dans le secteur.
Le cas de SVB
La faillite de SVB est malheureusement un exemple tout à fait classique d’une gestion catastrophique : un bilan de 212 milliards de dollars composé notamment, côté passif, d’environ 173 milliards de dépôts (essentiellement d’entreprises) et, du côté actif, de 112 milliards de titres à revenu fixe, principalement des créances garanties par des institutions bénéficiant du support du gouvernement américain (MBS) ainsi que des bons du Trésor de maturité supérieure à 10 ans. Malgré l’excellente qualité de ces titres, le bilan de la banque californienne était fort déséquilibré, car très exposé au risque de taux d’intérêt : l’augmentation des taux à 10 ans de 1,5% à 4% au cours de l’année 2022 [1] aura entrainé une perte de valeur sur ces titres de près de 15 milliards de dollars, ce qui correspond à la quasi-totalité des 16 milliards de dollars que comptaient les fonds propres de haute qualité (Core Equity Tier 1, CET1) de la banque [2]. Le plus surprenant dans cette histoire est que SVB était tout à fait consciente de sa large exposition au risque de taux, comme l’attestent des rapports de risque datant de 2021. Il est probable qu’elle n’y ait pas suffisamment porté attention, ayant l’intention de détenir ces actifs jusqu’à leur maturité (l’autre explication proviendrait d’une absence de gestion de risque, le poste de directeur financier (CRO) étant resté vacant pendant la quasi-totalité de 2022 [3]). Le faible rendement des titres détenus (qu’on estime à environ 2%) ne permettait pas à SVB de répercuter sur ses dépôts l’augmentation brutale des taux décidée par la FED. Le doute quant à la solidité de la banque s’était immiscé, et la chute fut précipitée par le retrait massif des dépôts issus d’entreprises (très réactives aux taux offerts), et dont la plupart excédaient le seuil de protection garantie de 250.000 dollars. On estime qu’environ 97% des 173 milliards dépôts de SVB provenaient d’entreprises, une situation très inhabituelle dans la mesure où les dépôts dans les banques de détail proviennent en général majoritairement des particuliers (moins réactifs à une variation de taux et avec des montants se situant souvent sous la garantie de l’Etat).
Le cas de Crédit Suisse
S’agissant de la 45ème banque la plus importante du monde en 2022 et d’une des plus grandes d’Europe, Crédit Suisse est un mastodonte. Néanmoins, cette institution accumule les problèmes depuis de nombreuses années. Il y a quelques mois à peine, en octobre 2022, elle accepta de verser une compensation de plus d’un demi-milliard de dollars lors d’une transaction financière avec les autorités judiciaires américaines dans le cadre de la résolution d’un conflit lié à la crise de 2008. A cette époque, son cours était d’environ 80 francs suisses (CHF). Dix ans plus tard, en mars 2018, il n’était plus que de 15 CHF pour terminer à environ 2 CHF avant son rachat par UBS (au prix de 76 centimes par action). De manière assez paradoxale, c’est l’un des plus gros actionnaires de l’institution suisse, la Banque nationale saoudienne, qui a allumé la mèche en indiquant ne pas être en mesure d’injecter de nouveaux capitaux dans la banque helvète en raison d’une part actuelle de 9,9%, un niveau proche de la limite maximale autorisée dans leur mandat (10%) [4]. Apporter la précision qu’une augmentation de capital de Crédit Suisse n’était, selon elle, pas nécessaire n’y changera rien : à la mi-mars, les retraits s’enchainèrent à concurrence d’environ 10 milliards CHF par jour.
Au suivant ?
Comme souvent dans le secteur bancaire, les séismes se propagent très rapidement, la plupart des actions financières ayant lâché près de 20% depuis leur niveau enregistré au début du mois de mars. Dès lors, faut-il redouter une contagion à l’ensemble du secteur ?
D’un côté, nous l’avons vu, les situations de ces deux institutions sont très particulières : SVB est une banque ayant un bilan très atypique, déséquilibré et essentiellement financé par des dépôts volatils d’entreprises très spécifiques (sociétés technologiques et investisseurs de capital à risque). De plus, son bilan étant inférieur à 250 milliards de dollars, elle n’était pas considérée comme une banque systémique par le régulateur américain, ce qui implique qu’elle n’était pas tenue de respecter des ratios de liquidités évoqués plus haut. Crédit Suisse, quant à elle, accumulait les problèmes depuis des années, et n’a pas pu bénéficier du soutien de son plus gros actionnaire pour des raisons de limite d’exposition atteinte. Il est donc très hasardeux de vouloir généraliser ces problèmes à l’ensemble du secteur.
La situation des banques européennes reste très bonne. La régulation y est une des plus strictes au monde. La Belgique, en particulier, se situe parmi les meilleurs élèves de la classe en termes de capitalisation. Avec 19,7% de CET1 et beaucoup de cash, les banques belges sont très bien capitalisées (top 6 en Europe) [5,6]. Initialement fixé à 60% en 2015, le seuil minimum requis pour le ratio LCR a été poussé à 100% sous les normes de Bâle III, en 2018. L’autorité bancaire européenne (EBA) rapporte que la moyenne de ces ratios sur plus de 300 banques se situe actuellement bien au-delà, autour de 170% [7]1.
Un point cependant nécessite une attention particulière : les ratios réglementaires de SVB et de Crédit Suisse étaient au vert. Ces banques étaient bien capitalisées (ratios CET1 et Tier One Leverage de 12,05% et de 8,11% pour SVB, et de 14,1% et 7,7% pour Crédit Suisse), plus du double des minimas requis. Bien que SVB n’était pas tenue de rapporter ses ratios de liquidité, plusieurs analystes s’accordent pour dire qu’ils auraient probablement été satisfaisants. C’était d’ailleurs le cas pour Crédit Suisse, dont les ratios de liquidité étaient de 144% (LCR) et 117% (NSFR), nettement supérieurs au seuil de 100% requis [8]. Du côté du régulateur, donc, ces banques étaient jugées suffisamment solides.
Faut-il en conclure que la régulation doit être renforcée ? Indéniablement, la règlementation est déjà très stricte, et pèse lourdement sur la rentabilité des banques, particulièrement en Europe. De plus, il faut prendre conscience que la régulation est un jeu d’équilibriste avec des effets potentiellement pervers. En effet, des contraintes excessives limiteront les profits des institutions financières, et pousseront donc les banques dans des situations plus précaires encore. D’un autre côté, force est de constater qu’une banque, même saine (dans le sens où elle remplit toutes les conditions requises par le régulateur) reste très vulnérable à un bank run, c’est-à-dire un retrait massif des dépôts. De manière intéressante, la modélisation de la panique bancaire et les crises économiques qui en résultent sont au centre des recherches de D. Diamond et Ph. Dybvig, lauréats du prix de la Banque de Suède en sciences économiques (connu sous l’appellation de prix Nobel en économie) 2022 avec l’ancien président de la FED, Ben Bernanke [9]. La période actuelle démontre qu’au-delà des risques financiers réels mesurés par une pléthore d’indicateurs sophistiqués, le talon d’Achille du secteur bancaire réside essentiellement dans les réactions émotionnelles des investisseurs et épargnants [10]. Elles sont le symptôme d’une perte de confiance dans le secteur mais aussi, ce qui est plus inquiétant, dans la capacité des autorités régulatoires à pouvoir évaluer correctement la solidité des banques, et à garantir la stabilité de l’écosystème financier. Les banques restent fortement exposées au retrait massif de dépôts, source principale de leur financement. La résistance au bank run est difficile à évaluer, mais la régulation bancaire gagnerait probablement à renforcer ses analyses sur ce type de scénarios.
1 Lorsque l’on analyse la solvabilité ou la prise de risque d’une institution financière, les montants absolus (tel que, par exemple, le montant des fonds propres) ne donnent pas une image complète concernant sa solidité; il faut analyser ces chiffres au regard des risques encourus. C’est la raison pour laquelle la régulation bancaire s’appuie sur des ratios où, en général, le numérateur correspond à des «rentrées» et le dénominateur à un «risque». Ainsi, par exemple, le taux de capitalisation CET1 correspond au rapport entre le montant de fonds propres de haute qualité et l’ensemble des actifs pondérés par les risques associés (risk-weighted assets, RWA, qui augmentent avec la prise de risque). Les banques belges ont, en moyenne, 19,7% de leurs RWA sous la forme de fonds propres de haute qualité. Le seuil minimum pour ce ratio, tel que déterminé dans les normes de Bâle III, est de 4,5%. D’autres ratios s’appliquent. Par exemple, les ratios LCR et NSFR mesurent la capacité qu’a l’institution financière de pouvoir faire face à des flux financiers sortants, pour lesquels les minimas requis sont actuellement de 100%. En Europe, ces ratios s’appliquent à toutes les banques (qu’elles soient systémiques ou non) et sont destinés à compenser le risque associé à la tendance naturelle qu’ont les banques à «jouer sur la courbe de taux», c’est-à-dire, à financer des besoins long-terme via des financements à court-terme. Cette approche permet à la banque de capter le différentiel de taux résultant de la différence de maturités entre actif et passif mais, comme l’illustre parfaitement le cas de SVB, elle entraine un risque de taux sur le bilan.
On en parle dans la presse...
L'Echo, page 9, 30.03.2023 : "Limiter les retraits peut avoir un effet salvateur contre un bank run", interview de Frédéric Vrins par Jean-Paul Bombaerts.